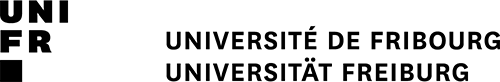Aimer son travail nuit-il à la santé ?
Quels sont les effets de l’amour de son travail sur la santé des travailleur·es ? Si aimer son travail semble être un ressort puissant de l’engagement professionnel, cela ne représente-t-il pas également un risque pour la santé ? A contrario, ne pas aimer son travail peut-il nuire à la santé ou au contraire la protéger ? En effet, avoir un rapport strictement utilitaire au travail peut-il être, d’une certaine manière, une stratégie pour concilier la vie professionnelle et la vie personnelle ? Pourquoi faut-il impérativement faire « corps » avec son travail, l’aimer et s’identifier à lui ? Aimer son travail, est-ce une nouvelle forme d’injonction véhiculée par le management ou une revendication des travailleur·es ? Autrement dit, aimer son travail joue-t-il comme un ressort de l’émancipation (via la subjectivation) ou de l’aliénation (via l’assujettissement) ? A contrario, comment fait-on dans ce contexte lorsque l’on n’aime pas son travail ?
L’exigence d’amour du travail rompt avec la tradition de l’impensé émotionnel associé au travail puisque, jusque dans les années 1970, décennie de basculement dans l’idéalisation du choix et de l’individualisme contemporain, cette question ne se posait pas. L’injonction généralisée à aimer son travail est consubstantielle de la montée du nouvel esprit du capitalisme (Boltanski & Chiapello, 1999) dans les années 1980. Ce vaste mouvement de romantisation du capitalisme promeut une forme radicale de l’individualisme où la réalisation et l’amélioration de chacun-e passent par le développement personnel et l’entrepreneuriat de soi (Brökling, 2015).
Comment comprendre cette centralité de l’engagement et de l’attente affective dans et pour son travail ? Quels sont les effets sur la santé du fait d’aimer ou non son travail ?
Depuis la fin des Trente Glorieuses, le fonctionnement des organisations s’est caractérisé par un accroissement considérable de la flexibilité de la production, de l’emploi et du travail pour faire face à des marchés devenus plus volatils et à une concurrence accrue entre les entreprises dans un contexte de mondialisation. Sous l’influence du néolibéralisme, les structures et les modes de gouvernance des entreprises ont cherché à répondre de manière plus rapide et plus fine aux variabilités de l’offre et de la demande, ainsi qu’à la diversité des besoins de la clientèle, tout en réduisant les coûts de fonctionnement (Hanique, 2004 ; Ségrestin & Hatchuel, 2012 ; De Gasparo, 2021).
Entreprise en réseau, gestion par projets, holacracie, sous-traitance, etc. : ces formes d’organisation et de gestion se caractérisent par un double mouvement paradoxal (Linhart, 2009, 2015 ; Deranty, 2011 ; De Gaulejac & Hanique, 2015). D’un côté, elles laissent penser qu’elles donnent plus de responsabilité et de marge de manœuvre aux unités locales et aux individus, pour faire face aux fluctuations de la production. De l’autre, elles encadrent cette décentralisation, parfois de manière très serrée, au travers de normes, de systèmes de reporting et de technologies de traçabilité. Dans ce contexte, les individus sont appelés à faire preuve de créativité (Amado, Bouilloud, Lhuilier & Ulmann, 2017), d’autonomie et d’innovation, à s’engager dans leur travail, à s’identifier à leur équipe et à leur employeur, à prendre du plaisir dans leur activité
professionnelle, et même à y trouver du bonheur (Askenazy, 2009 ; Boltanski & Chiapello, 1999 ; Le Garrec, 2021 ; Vallas & Cummins, 2015).
Les configurations actuelles du travail reposent sur cette tendance croissante à la subjectivation des salarié·es, entendue comme « l’engagement subjectif dans l’activité et la mise au travail d’affects, valeurs et dispositions relationnelles » (Périlleux, 2003).
Travailler, c’est aussi s’exposer à de la souffrance, à des risques, à de l’usure, à la répétitivité, à des horaires irréguliers et, plus largement, à différentes formes de contraintes (Dujarier, 2021 ; Clot & Lhuiler, 2010). La psychodynamique du travail et la clinique de l’activité se fondent d’ailleurs sur cette ambivalence du travail entre souffrance et plaisir. Selon les contextes, le travail peut participer de la construction de la santé, mais aussi de sa fragilisation (Clot, 2010 ; Clot & al., 2021 ; Davezies, 2021, Marquis, 2014). Si cette tendance ne recouvre pas l’ensemble des situations de travail, l’engagement de soi dans le travail se trouve cependant au cœur des prescriptions gestionnaires contemporaines (Bourel & Hayem, 2019 ; Boussard & al., 2020 ; Dujarier, 2015 ; Cabanas & Illouz, 2018).
Dans le même temps, une partie des jeunes arrivant sur le marché du travail (ou de moins jeunes en quête de changement) vient questionner ce modèle gestionnaire, en revendiquant de nouvelles attentes : des temps de travail réduits permettant des activités et des engagements para-professionnels ou privés. Les réactions diverses des employeur·es face à ces nouvelles appréhensions de la vie – professionnelle et personnelle – soulignent à quel point le modèle du travail « total » et nécessairement épanouissant reste pourtant dominant.
Aussi, le rapport strictement utilitaire à son travail est-il en voie de disparition dans un monde qui prône la réalisation de soi par le travail ? L’amour de son travail prend-il des formes différentes selon les situations de travail ou les caractéristiques individuelles (type d’activité, taux d’occupation, position professionnelle, sexe, classe, « race », âge, etc.) ? Quels intérêts les discours sur le plaisir au travail servent-ils concrètement ? Dans quelle mesure les attentes des travailleur·es et des directions d’entreprises convergent-elles ?
Telles sont quelques-unes des perspectives que nous souhaitons aborder lors de ces journées.